|
Faubourg Saint Antoine
Chers amis,
Nous marcherons donc sur et à côté du
Faubourg Saint Antoine le vendredi 24
janvier.
Donnons nous rendez vous devant le 2, rue de la
Roquette métro Bastille à
9h. 30. (voir photo en fichier
attaché).
Je vous suggère de prendre ensuite un
plat du jour ( et plus si affinités...) au café des Phares, 7 place de le
Bastille. Il a le mérite d’être vaste. Donnez votre accord pour que je puisse
réserver au moins approximativement.
Je vous enverrai des infos sur
l’histoire des lieux quelques jours avant la balade car en janvier la longueur
des stations debout immobiles est à réduire. On en a l’expérience n’est ce pas
?
A
bientôt
Bises
Catherine
==> Album Photo en cliquant ici
-->
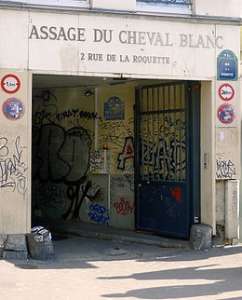
FAUBOURG SAINT ANTOINE (Wikipedia à peine
retouché)
La rue du Faubourg-Saint-Antoine, qui constitue
aujourd'hui la limite entre le 11e et 12e arrondissement de Paris est un des plus vieux axes de la capitale. Elle tire son
nom de l'abbaye Saint-Antoine des champs, détruite à la fin du
XVIIIe siècle. Elle s'est appelée chaussée Saint-Antoine, entre
la place de la Bastille et la rue de Montreuil, et rue du chemin de Vincennes
au-delà.
Le Moyen Age
En
1198,
Foulques
de Neuilly, prédicateur de la IVème croisade fait construire un petit
ermitage pour femmes dépravées, au milieu des marais alimentés par les ruisseaux
qui descendaient des collines de Ménilmontant ou de
Belleville, le long de
cette longue route sinueuse ( ancienne voie
romaine) qui reliait le centre de Paris à Meaux.
En
1204, le couvent est transformé en abbaye
cistercienne et fortifié.
L’eau des fossés est amenée de la Seine par des canaux. Des hommes armés la défendent sous les
ordres de l'abbesse que l'on
surnomme « La Dame du Faubourg ». Son église est consacrée à
saint Antoine.
En
1229, le roi Louis IX en fait une
abbaye royale. Les faveurs royales dont bénéficient les religieuses
rejaillissent sur tout le faubourg. De nombreux artisans se pressent aux abords
de l'abbaye. Ils demeurent
rattachés aux corporations
parisiennes.
Peu à
peu, les marécages sont asséchés puis cultivés. La proximité de la Seine
permet l'approvisionnement en bois et encourage l'installation de professionnels
du meuble.
Saint Louis
fait une entrée remarquée par cette voie en 1239, à son retour de Croisade,
portant la Sainte Couronne d'épines.
En 1261 il
confirme une loi interdisant le vagabondage des cochons. Il exempte l'abbaye de Saint-Antoine,
qui pourra ainsi laisser vaquer ses porcs, à condition de les munir d'une
clochette marquée d'une croix afin qu'on les reconnaisse.
En
1471,
l'abbaye
Saint-Antoine-des-Champs bénéficie de
la part de Louis
XI d'un rare privilège : l'affranchissement de la tutelle des
corporations. Exemptés de lourdes taxes, les artisans s'installent autour de
l'Abbaye. Pendant plus d'un siècle et demi, le Faubourg met à profit cet
avantage pour s'écarter des modèles jusque-là sévèrement réglementés et la
profession commence à utiliser d'autres bois que le chêne. Cela ne dure
pas : Louis
XIII crée les Jurandes de Faubourg.
Mais en 1657, par lettre
patente,
Colbert les
abolie.
Au milieu du
XVIIe siècle, l'abbesse,
parfois de sang royal, a dans son fief une cinquantaine de rues. L'abbaye
elle-même ne peut accueillir plus d'une vingtaine de jeunes filles, à qui l'on
offre, l'éducation, le chauffage et le blanchissage.
Elle s'occupe
aussi d'approvisionner le quartier.
Le faubourg
Saint-Antoine sous le Fronde, est
le théâtre, le 2 juillet 1652, de violents
affrontements entre les troupes royales dirigées par Turenne et les
frondeurs de la
Grande Mademoiselle commandés par
Condé. Des hauteurs
de Charonne, le jeune roi
Louis XIV assiste alors
aux combats aux côtés du Cardinal Mazarin.
Ébénistes, vernisseurs, doreurs, parquetiers, tapisseurs, sont
désormais nombreux dans le quartier de Saint-Antoine et un concours d'artisans
étrangers permet l'utilisation de techniques nouvelles ou de matériaux
exotiques. La verrerie fait aussi son entrée dans le quartier, le Roi accordant
une subvention exceptionnelle pour l'installation d'une manufacture de verre
vénitien, qui deviendra, en 1692, la
Compagnie
de Saint-Gobain. Au
début du XVIIIe siècle, un
millier de menuisiers et ébénistes sont rejoints par quantité de façonniers, qui
répandent leurs créations dans les hôtels particuliers de Paris. De là viendra
son surnom de « faubourg du
meuble ».
Un
demi-siècle plus tard, le quartier Saint-Antoine est le plus peuplé de Paris.
Indigents et ouvriers grouillent sur le pavé, formant dans la capitale un foyer
d'agitation exceptionnel. Le caractère villageois du faubourg Saint-Antoine
persiste. On parlera d'un « cratère d'or » d'où s'échappe
le plus souvent la lave révolutionnaire.
C'est que le faubourg Saint-Antoine est l'un des plus
« ouvriers » de Paris. Il est composé d'une population en prise avec
des problèmes économiques. Cependant il participe au luxe d'une clientèle
aristocratique dont il subit la morgue. Il mesure l'importance de ses privilèges et
de son pouvoir d'achat. Il en vit mais le
jalouse
Les grandes journées révolutionnaires
doivent leur succès à l'apport populaire du faubourg
Saint-Antoine.
L'émeute de
Réveillon
Au
coin de la rue du Faubourg-Saint-Antoine et de la rue
de Montreuil,
était installée dans la maison de la Folie
Titon une
manufacture de papiers peints et veloutés tenu par Jean baptiste Reveillon qui
employait quatre cents ouvriers. En avril 1789, il propose une diminution du
salaire des employés de manufactures. Cette mesure .touche les plus
pauvres et s'avère donc très impopulaire. Le 28
avril 1789, la
manufacture est mise à sac et incendiée. On cite, parmi les agitateurs, qui
auraient encouragé l'attaque, Philippe
Égalité.
Les gardes français tirent sur la foule au soir du 28 avril faisant environ 300
morts qui sont enfouis dans les catacombes, et
un millier de blessés. L'émeute
de Réveillon est
une des plus sanglantes de la Révolution.
Elle provoque une grande rancœur dans la foule, et la fixation sur le faubourg Saint-Antoine de la
colère qui va exploser le 14
juillet
1789.
Lors de la prise de la Bastille (14 juillet 1789), une grande
partie des émeutiers proviendra du faubourg
Saint-Antoine.
La Journée du 10 août
1792 C'est du faubourg Antoine, renommé ainsi, que
part le gros du cortège à l'assaut des Tuileries, avec à sa tête le brasseur Antoine Joseph
Santerre,
dont le dépôt de bière, servira de ralliement insurrectionnel.
Émeutes des
journées de Prairial an III
Le
1er Prairial an
III
(20 mai 1795),
des émeutiers des sections jacobines de
Saint-Antoine et Saint-Marceau
envahissent la salle de la Convention pour réclamer du pain et l'application de
la Constitution
de 1793. Le
député Jean
Féraud,
qui tente de s'interposer, est abattu et sa tête tranchée et portée au bout
d'une pique jusqu'au Président de l'Assemblée, Boissy
d'Anglas.
L'émeute rebondit le 4. À l'angle de la rue
de Charonne est
ce jour-là dressée l'une des barrières bouchant le faubourg Saint-Antoine sur
laquelle s'affrontent les Thermidoriens et
les émeutiers. Le faubourg tombe, pour la première fois depuis 1789. S'ensuit
une longue série d'arrestations marquant le début de la
répression.
La
Révolution,
qui pourtant tira beaucoup d'énergie du faubourg Saint-Antoine, sonna néanmoins
le glas du rayonnement économique du quartier. En effet, la plupart des
nobles et
des riches
bourgeois qui
s'approvisionnaient autrefois dans les ateliers du faubourg, étaient ruinés,
exilés ou avaient été exécutés. Plusieurs ateliers firent faillite et de
nombreux ouvriers étrangers s'enfuirent Et si le bois reste ensuite la
première activité du quartier, c'est la diversification et l'industrialisation
qui la sauveront d'une mort certaine. Profitant de la
révolution
industrielle qui
permet l'amélioration des techniques de fabrication, l'artisanat du meuble se
reconvertit en manufactures. Viennent s'y ajouter de nouveaux
métiers
tels le textile ou la chaudronnerie.
La
Restauration
Le
9
juin
1820,
lors des obsèques de Nicolas
Lallemand,
étudiant abattu par un Garde Royal, la manifestation sur les boulevards se
grossit de nombreux ouvriers issus du faubourg
Saint-Antoine.
Le
vivier révolutionnaire du faubourg Saint-Antoine réapparaît lors des émeutes de
1830. Le
26
juillet, la
promulgation des ordonnances
de Saint-Cloud
provoque la révolte des Parisiens. Dans le faubourg se dressent les premières
barricades.
En
réaction, la mise en place aux extrémités de la rue des statues des
rois Saint
Louis et
Philippe-Auguste sur
les colonnes
du Trône
(1843)
d'une part, et du Génie de la Bastille sur la colonne
de Juillet
(1840)
d'autre part, chacune tournant le dos au faubourg, lui valut le surnom de
« faubourg des Trois-Culs ».
La
Révolution
de 1848 et la
Seconde
République
Le
30
septembre 1846,
c'est une fois encore du faubourg que sortent les premières agitations contre
l'augmentation du prix du pain. La troupe devra intervenir pour rétablir
l'ordre. Le 25
juin
1848, 29
barricades couvrent le faubourg,
dernier bastion à se rendre, après la mort de l'archevêque de Paris,
Mgr Affre.
Le
Second
Empire et la
Commune
Après le
coup
d'État du
2
décembre
1851,
Jean-Baptiste
Baudin, jeune
médecin député de
l'Ain et ami de
Victor
Hugo, rédige
un manifeste contre Louis-Napoléon
Bonaparte. Il monte
le lendemain sur les barricades qui s'élèvent dans le faubourg Saint-Antoine. Un
coup de feu part. La troupe riposte, blessant mortellement le jeune Baudin.
L'annonce de sa mort provoque une nouvelle insurrection qui sera
finalement écrasée par
l'armée.
En
1860, avec les
remodelages du Baron Haussmann, la rue du
Faubourg-Saint-Antoine sépare deux arrondissements nouvellement créés : le
XIe et le
XIIe.
Sous
l'impulsion de Napoléon
III, la
préservation des Beaux-Arts redonne
un souffle nouveau à la création ébéniste du Faubourg dont l'influence redevient
internationale. Cette réputation lui valut d'être connu comme « le faubourg du meuble ».
Lors de la
Commune de
1871 se joignent
alors aux ébénistes du faubourg Saint-Antoine les ouvriers des chantiers
d'Haussmann ainsi que ceux de Belleville ou de Montmartre. Le quartier
est l'un des derniers à tomber sous l'avancée des Versaillais de
Thiers qui s'achève
au cimetière du Père-Lachaise.
Construction d'une barricade au faubourg
Saint-Antoine en
1870
La 3eme Republique
L'ouvrier orfèvre et
anarchiste Georges
Deherme fonde au
no 157, au débouché de la rue
d'Aligre, la
première université
populaire de
France, la Coopération des Idées, qui comptera, en 1904, 11 861 membres, dont 80 % d'ouvriers
| 